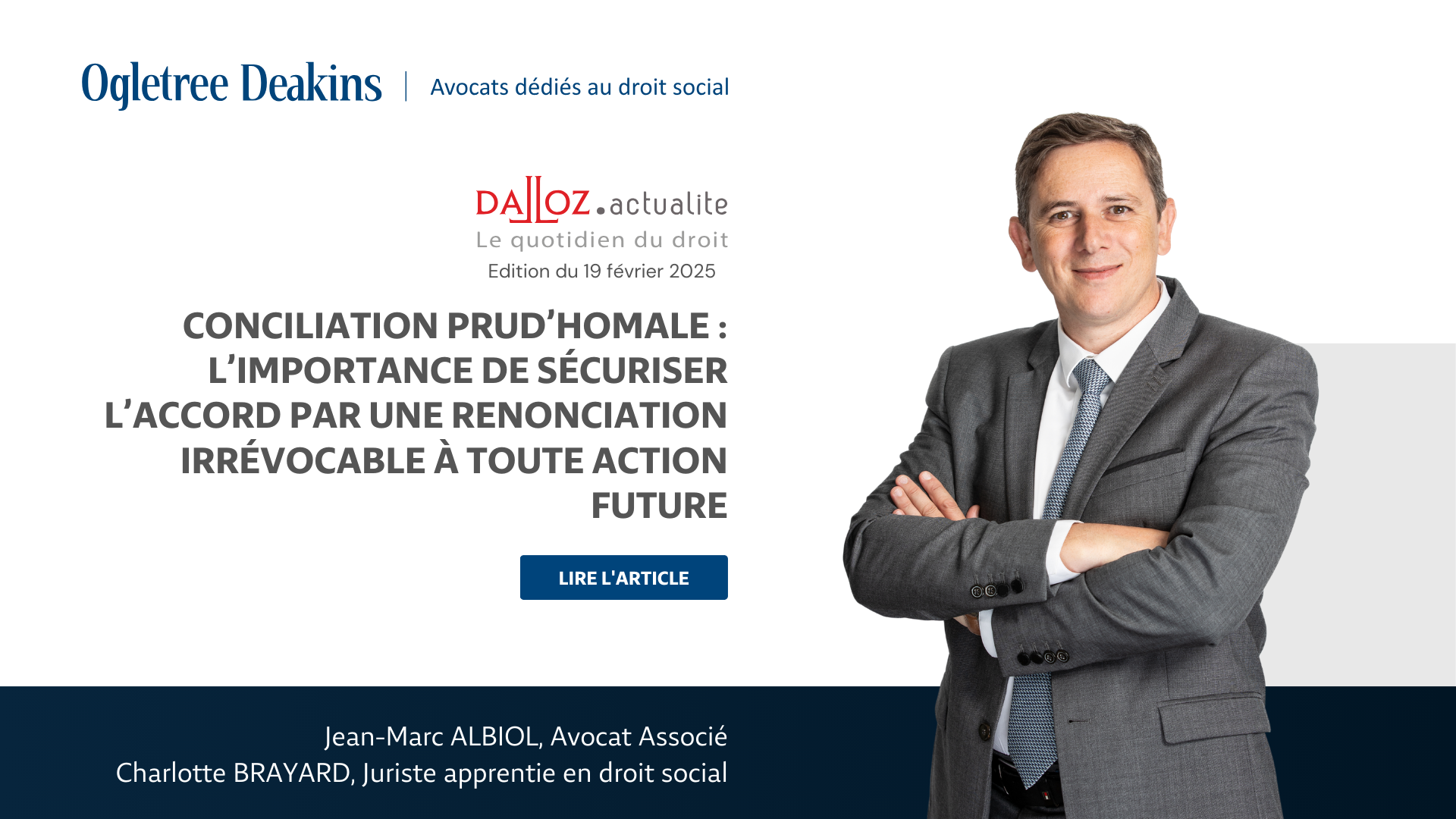SOCIAL | Contrôle et contentieux
Une décision du 5 février 2025 vient préciser la portée d’un procès-verbal de conciliation. L’objet de la conciliation se limite aux prétentions des parties telles que fixées par l’acte introductif d’instance ainsi que par leurs écritures, sauf à ce que le procès-verbal ne contienne une clause de renonciation expresse et irrévocable à toute action portant tant sur l’exécution que sur la rupture du contrat, comparable à celle d’une transaction.
par Jean-Marc Abiol, Avocat associé et Charlotte Brayard, Apprentie juriste en droit social, Ogletree Deakins, Cabinet dédié au droit social
Extrait de l’article :
Introduction
Bien que le succès de la conciliation préalable en matière prud’homale ne soit que résiduel en ce que seulement 15 % des affaires traitées par les conseils de prud’hommes ont été résolues au stade du bureau de conciliation et d’orientation en 2023, cette étape préalable n’en demeure pas moins obligatoire. Ce principe de préliminaire de conciliation est une spécificité de la matière prud’homale, qui trouve sa source dans l’article L. 1411-1 du code du travail, lequel dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ». Ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que l’affaire est transmise au bureau de jugement. Ce principe est affecté d’exceptions ponctuelles, justifiant qu’une affaire soit portée directement devant ce bureau. Tel est le cas notamment des demandes de requalification d’un CDD ou d’un contrat de mission de travail temporaire en CDI (v. par ex., Soc. 8 mars 2017, n° 15-18.560, JA 2018, n° 572, p. 39, étude J.-F. Paulin et M. Julien ; Dr. soc. 2017. 843, chron. S. Tournaux ; RDT 2017. 347, obs. S. Mraouahi ; ibid. 415, obs. S. Tournaux ), ou d’une demande de requalification d’une démission en prise d’acte (C. trav., art. L. 1454-1).
Le principe de conciliation obligatoire est également évoqué à l’article R. 1454-10 du code du travail, en application duquel « Le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi ». La décision du bureau de conciliation et d’orientation prend alors la forme d’un procès-verbal, qui n’est autre qu’un contrat judiciaire dressé en la forme authentique, insusceptible de recours (Soc. 15 déc. 1971, n° 70-40.580).
Concrètement, la conciliation préalable obligatoire constitue une formalité substantielle (Soc. 6 juill. 1978, n° 76-40.728), dont l’existence justifie qu’une clause du contrat de travail instituant une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend. En effet, l’inefficacité des clauses de conciliation précontentieuse insérées dans le contrat de travail est due à l’impératif de conciliation déjà imposé par le code du travail en matière prud’homale (Soc., avis, 14 juin 2022, n° 22-70.004, Dalloz actualité, 1er juill. 2022, obs. T. Goujon-Bethan ; D. 2022. 1158 ; ibid. 2330, obs. T. Clay ; RDT 2022. 529, obs. S. Mraouahi ; Rev. prat. rec. 2022. 7, chron. D. Cholet, R. Laher, O. Salati et A. Yatera ; ibid. 24, chron. B. Gorchs-Gelzer ; RTD civ. 2022. 706, obs. N. Cayrol ; v. J.-Cl. Travail Traité, v° Conseils de prud’hommes – Procédure, par T. Lahalle, fasc. 81-40). Outre sa nature d’acte judiciaire, la procédure de conciliation préalable obligatoire se distingue des autres modes de règlement amiable en raison du rôle actif du bureau de conciliation dans la recherche d’un accord entre les parties. En ce sens, la jurisprudence a pu affirmer de manière expresse que la participation active du bureau de conciliation et d’orientation, ainsi que l’information effective des parties sur leurs droits respectifs constituent une condition de validité du procès-verbal de conciliation, sans laquelle l’accord pourrait être remis en cause par la saisine de la juridiction prud’homale (Soc. 28 mars 2000, n° 97-42.419, D. 2000. 537 , note J. Savatier ; Dr. soc. 2000. 661, obs. M. Keller ).
Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que « le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre ». Cette disposition a semé le doute quant à la portée de la conciliation prud’homale : est-elle « globale », comme tel était le cas avant cette réforme, ou purement et simplement « limitée » aux cas de rupture du contrat de travail ? Le procès-verbal de conciliation emporte-t-il renonciation à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, ou uniquement sur sa rupture ?
Une décision antérieure mais récente de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 avril 2024 a levé le doute sur cette incertitude (Soc. 24 avr. 2024, n° 22-20.472, D. 2024. 876 ). Dans cette espèce, les parties étaient convenues du versement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, de sorte que l’accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d’instance et d’action pour tout…
*Pour lire l’article complet cliquez ici.